André Louis Wierzbolowiez est le fils de Jean André Wierzbolowiez, mécanicien, ancien lutteur devenu forain, et de son épouse Marie Eugénie Lachenal, perleuse. Il naît le 16 août 1893 à Paris (20e arr.). Il est confié à sa grand-mère par ses parents.
Wierzbolowiez effectue probablement à partir de 1913 son service militaire puis la première guerre mondiale dans la marine, ce qui l’amène à passer par exemple le détroit de Magellan.
Il épouse à Joinville-le-Pont (Seine, act. Val-de-Marne) Anne Marguerite Cotrone en septembre 1917. Il s’installe après-guerre dans la commune.
Présenté comme autodidacte, Wierzbolowiez est d’abord dessinateur industriel. Il devient libraire vers 1918 et, dans les années vingt, il est le gérant de la librairie du journal, devenu communiste, L’Humanité, située à Paris au 120, rue Lafayette, où il est connu sous le pseudonyme « André ».
André Wierzbolowiez se présente sur la liste du syndicat Cgtu, proche des communistes, aux élections prud’homales du 13 novembre 1932 dans la huitième catégorie de la section commerce, s’identifiant comme « employé de librairie ». Il recueille 14 voix sur 275 suffrages exprimés soit 5%, loin derrière le candidat de la Cgt qui en a 34 et surtout celui de la Cftc (catholique), élu avec 227 votes.
Lors des élections municipales des 5 et 12 mai 1929, Wierzbolowiez est candidat en 8e position sur la liste du Bloc ouvrier et paysan (BOP, communiste) aux élections municipales à Joinville-le-Pont. La liste est conduite par le futur député de Seine-et-Marne Roger Bénenson. Elle obtient en moyenne 391 voix au premier tour, soit 18,4 % des suffrages exprimés. Au second tour, elle se maintient contre la liste du cartel des gauches, conduite par le radical Georges Briolay, qui comprend des socialistes SFIO. La liste BOP recueille 278 voix en moyenne (12,5 %). La liste radicale et socialiste remporte 22 sièges, contre 5 à une liste de droite ; les communistes n’ont pas d’élus.
Au cours d’un scrutin municipal partiel à Joinville en octobre 1934, provoqué par la vacance de 10 sièges sur 27, Wierzbolowiez est annoncé comme devant conduire la liste communiste. Cependant, il est exclu du Parti communiste en raison de son opposition à la politique d’alliance avec les socialistes et il sera remplacé par Robert Laforest en tête de liste.
André Wierzbolowiez avait dû quitter son emploi de libraire, sans doute dès 1933, du fait de ses divergences, et il se met à la recherche d’un emploi.
Il est recruté par Jean Fréville, probablement en 1935, avec lequel il va collaborer à l’écriture de plusieurs ouvrages. Jean Fréville est le pseudonyme d'Eugène Schkaff (1895-1971), né à Kharkov (Ukraine), collaborateur de Maurice Thorez. Selon les historiens Paul Boulland, Claude Pennetier et Rossana Vaccaro, André Wierzbolowiez aurait fourni les matériaux de Pain de brique, premier roman de Fréville, consacré à des grèves de 1936 et publié en 1937, ainsi que de Port-Famine, dans lequel un autre historien, Philippe Robrieux, considère que Wierzbolowiez utilise ses souvenirs de marin passé par le détroit de Magellan.
Jean Fréville lui aurait demandé, en 1935, de l’aider à rédiger la biographie du secrétaire général du parti communiste que Maurice Thorez fit publier en 1937 aux Éditions sociales internationales sous le titre Fils du peuple. Selon Philippe Robrieux, Wierzbolowiez serait le véritable auteur de la biographie. Cependant, l’écrivain socialiste Victor Fay relativise le rôle son rôle, estimant que « Maurice Thorez donnait des indications, les lignes directrices, racontait des anecdotes, des faits marquants. Fréville prenait des notes détaillées, rédigeait le texte, puis le confiait à taper à André Wierzbolowiez, l’ancien libraire du Parti, devenu son secrétaire. »
Pour Louis Robert et Danielle Tartakowsky, Wierzbolowiez est le rédacteur probable de l’acrostiche désignant Fréville comme l’auteur de Fils du peuple au prétexte d’une pseudo-description du territoire natal de Thorez après la première guerre mondiale : « ...ferrailles rongées et verdies, informes lacis, larges entonnoirs aux escarpements crayeux, ravinés, immenses, tranchées creusées en labyrinthes, infranchissables vallonnements ravagés, embroussaillés ». Les initiales de chaque mot donnent : « Fréville a écrit ce livre » ; le passage disparaît dans les éditions ultérieures.
Si Wierzbolowiez n’a plus d’activité publique connue après son exclusion du Pcf, il semble s’intéresser toujours à l’évolution du communisme. Il reprend ainsi contact avec André Marty, quand ce dernier est lui-même exclu en juin 1953, s’adressant à lui en tant qu’ancien marin, et lui faisant grief dans une lettre privée d’avoir « une mentalité quelque peu fayot. »
André Wierzbolowiez, qui résidait peut-être toujours à Joinville, décède à Créteil (Val-de-Marne) le 30 décembre 1980, à l’âge de 87 ans. Son fils André fut champion de Paris junior en football de 1935 à 1937 et joua avec les équipes du CA Paris et du FC Perreux.
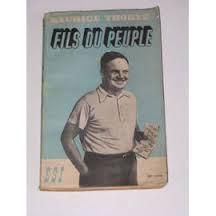
commenter cet article …




/image%2F1166198%2F20181215%2Fob_f23701_2018-12.png)